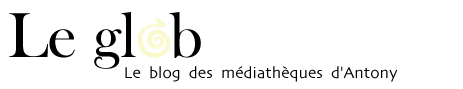Après le silence fait partie de la sélection « roman français » du Prix des lecteurs d’Antony 2016. Marie-Claire, fidèle lectrice et rédactrice du blog A bride abattue http://abrideabattue.blogspot.fr nous fait partager son enthousiasme…
Après le silence fait partie de la sélection « roman français » du Prix des lecteurs d’Antony 2016. Marie-Claire, fidèle lectrice et rédactrice du blog A bride abattue http://abrideabattue.blogspot.fr nous fait partager son enthousiasme…
Ne ratez pas la rencontre avec l’auteur le samedi 6 février à 16h à l’espace Vasarely…
Après le silence est un premier roman. Magistral.
Mouleur syndicaliste aux Fonderies et Aciéries du Midi, Louis Catella s’épuise dans la fournaise des pièces à produire et le combat militant. Il raconte cela, mais aussi la famille, l’amour de sa femme Rose, le chahut de ses trois garçons, les efforts rageurs pour se payer des vacances... Une vie d’ouvrier, pas plus, pas moins. Jusqu’au grand silence du 16 juillet 1974 quand Louis meurt accidentellement à l’usine sous les yeux de son fils ainé, âgé de tout juste 16 ans. Et pourtant l’impossible monologue se poursuit, jusqu’à ce que s’élève la voix du plus petit qui, depuis l'âge de 7 ans et désormais à jamais sera un enfant sans père.
On dit "la vie continue". Cette phrase est insupportable pour Rose qui vit chaque nouveauté, même le changement d’un meuble ou le remplacement d’un appareil ménager comme un deuil supplémentaire : pour moi, ton père est toujours là. (p. 120)
De fait, la voix paternelle s’élève, dans une sorte de tumulte alimentée d'une logorrhée haletante et inépuisable, traversée parfois de remarques sorties d’autres bouches. Le lecteur se demande comment il peut bien nous interpeler depuis l’au-delà. Nous faire à ce point sentir le poids de la fatigue, jusqu’à l’écrasement (p. 23). Celui qui parle ne croit pas si bien dire.
L’homme dont on nous trace le portrait croit au parti communiste et en Dieu. Il croit que la vie peut changer grâce aux hommes. (p. 25) Après 68 l’Idée a fui. Pas de Dieu. Cinq semaines d’espoirs et de certitude qu’il faut désormais enterrer. (p. 38)
Le père de Louis buvait, fumait … trop … Il mourra à l’hôpital, accidentellement. On ne cherche pas, c’est la mort (p. 45). Nous comprenons que l’usine impose alors sa loi à l’ouvrier et à sa famille. L’école n’est pas une issue, au contraire puisqu’elle retarde le moment de gagner sa vie. (p. 44) Les temps ont changé mais le petit-fils est atteint de phobie scolaire. Alors on le fait embaucher pour qu’il découvre ce qu’est le travail, provoquer l’étincelle qui lui redonnera goût à l'école. Il n’y a rien à craindre … sauf l’accident auquel il assiste.
Le docteur Massi, comme le beau-frère Henri constituent la garde rapprochée qui aide la veuve de son mieux. On lui conseille de refuser l'épaisse enveloppe de billets que l'assistante sociale de l'usine cherche à lui remettre contre la promesse de ne pas porter plainte. Le procès se soldera par une faute inexcusable et un franc symbolique de dommages.
En savoir +
Le blog "A bride abattue"219 accidents mortels ont eu lieu dans les Bouches-du-Rhône pour la seule année 1974. Avec une telle statistique on devine que l'espérance de vie d'un ouvrier ne pèse pas très lourd. De toute façon si l’ouvrier ne meurt pas d’un accident du travail, il mourra tôt ou tard de son état, il mourra de sa retraite misérable. (p. 212) Ces chiffres donnent au roman une portée considérable, bien au-delà d'un récit qui est bien davantage qu'autobiographique. C'est la chronique de la France ouvrière des années 60-70, que j'ai (un peu) connue.
Une époque marquée par l'espoir. Celui qu'après les terribles années de guerre le travail rende réellement libres les hommes et les femmes de bonne volonté.
Les souvenirs remontent à la surface, charriés par les remous de la mémoire, de ce qui a été raconté, déformé peut-être, les truites pêchées à la Javel (dont l’auteur nous donne même deux versions p . 59), le trauma crânien du plus jeune, le CAP tenté et échoué, l’ordinaire comme l’extraordinaire.
Ce roman se révèle être un dialogue, entre le père et le fils, le plus jeune, celui qui a envie d’écrire, qui écrit (p. 69) et qui finira par s’emparer du stylo et ne plus le rendre, à partir de la page 197 pour parler après le silence, conjurer la peur de disparaitre lorsqu'il aura atteint, voire dépassé, l'âge de son père.
Didier Castino, professeur de lettres à Marseille, nous offre un récit choral extrêmement bien écrit qui se lit comme un témoignage à charge et une quête de vérité. Il est honnête en s'interrogeant : où est la vérité? Je sais ou j'imagine ?
Il se situe à contre-courant de la répétition de la filiation. Je ne suis pas ouvrier, j’ai rompu la malédiction clame-t-il haut et fort. Quand il invective son paternel on imagine ce qu'auraient été leurs querelles à l'adolescence : Toi l’ouvrier syndicaliste, exemplaire, tu aurais un fils qui vote à droite. La tendresse est néanmoins présente à chaque page. Et la pudeur se cache derrière l'emploi de mots crus parfois. On comprend aussi combien l'enfant a été effrayé de cet homme censé tout voir (puisque du ciel on surveille tout), à qui rien ne pouvait échapper, aucune bêtise, aucune faiblesse.
J'ai reconnu là la sévérité de l'éducation des années 70 qui s'apparentait à une forme de terreur. Il fallait ramener des bulletins de notes exemplaires, être premier de la classe, toujours, pour panser la crainte familiale de n'avoir pas de travail une fois adulte.
Les familles ne se rendaient pas compte qu'elles soumettaient leurs enfants à une double injonction : celle de réussir, mieux que les parents, mais celle aussi de ne pas trahir leur classe sociale. Il faut beaucoup de temps pour parvenir à supporter la honte et la fierté des origines : Mais je ne suis coupable de rien. Je ne suis pas ouvrier. Il n’y a pas de mal à ça. (…) mais je reste un fils d’ouvrier. Et je peux parler à ta place quand ça me chante.
L'auteur s’insurge à la fin contre la mode de transformer les usines en lieux culturels. Si elles ferment, il faut les détruire, tout raser, ou les transformer en lieu de mémoire. Comme les camps de concentration. Raconter, après le silence, ce qui s’est passé pour que les jeunes sachent, pour que jamais on n’oublie. (p. 221)
J'ai visité il y a quelques années le centre minier de Lewarde dans le nord de la France. J'avais été bouleversée par ce que j'avais perçu de l'enfer dans lequel travaillaient les mineurs. C'est un souvenir indélébile. Le roman de Didier Castino est de la même veine. Il mérite amplement le Prix du Premier roman 2015.
Après le silence de Didier Castino chez Liana Lévi, en librairie depuis le 20 août 2015
Livre chroniqué dans le cadre du Prix 2016 des lecteurs d'Antony
En compétition avec Un amour impossible de Christine Angot, Quand le diable sortit de la salle de bain de Sophie Divry, L'orangeraie de Larry Tremblay, et Ce pays qui te ressemble de Tobie Nathan.

Retrouvez ce livre dans les médiathèques d'Antony
Mots-clés Prix 2016 des lecteurs d’Antony